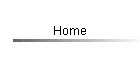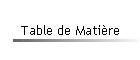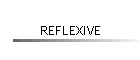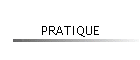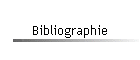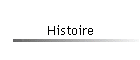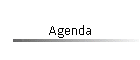C. Textes de théologie en interdisciplinarité
»
bibliographie.
________________________
Dire
et signifier la différence:
dégager un espace pour vivre
________________________
Michèle Bolli, Lausanne, CH
Avant-propos
Ce texte a été rédigé pour un colloque autour de l'oeuvre de Luce Irigaray, à
Lausanne. Depuis de longues années, j'ai noué, avec elle et son oeuvre, un
dialogue critique et constructif, s'élançant du territoire de la théologie vers
celui de la philosophie. Mme Irigaray étant l’une de celles qui a mis en
évidence la rareté de l’inter-locution entre sujets féminins dans la culture
européenne, j’ai choisi d’occuper ce lieu pour développer mon propos.
1. La différence conduit à une éthique du sujet-féminin
Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience" R.
Char
« Dire, me rapprochant de vous, que la vie au féminin apparaît donc prise dans
une importante tension entre deux axes: le premier: devenir, à partir de la
singularité d'une personne sexuée; geste éthique qui oblige à se distinguer
toujours et encore et de l'enveloppe et de la chose (comme vous le dites si bien),
et de la simple image et du seul corps, et du masculin et du pluriel.
Et le second: la nécessité de s'exposer à rencontrer des altérités inscrites
dans le monde, apportant parfois un dynamisme spirituel qui signe la Proximité
de cette Altérité divine que je cherche à connaître. Geste éthique qui relève du
courage d’être (comme a dit P.Tillich) mais aussi du jeu; du discernement, mais
aussi de la solidarité, et de l'inscription d'une personne sexuée, dans la vie
communautaire.
2. Trois points de distinction entre nous
Ces trois points de distinctions sont nés de trois moments de dialogues et de
confrontations. Ils avaient été précédés d'une rencontre avec l’un de vos livres
– Luce Irigaray - (‘Ce sexe qui n’en est pas un’, Minuit, Paris, 1977) .Texte
suffisamment étonnant pour être inclus dans le corpus travaillé dans mon mémoire
de Licence (intitulé: ‘Le féminin dans l'écriture et l'écriture au féminin’).
Puis, d’une rencontre, lors d'une conférence entendue à Zürich, à l’occasion
d'un colloque hégélien, intitulé De l'universel.
a. Un autre colloque, à Bologne au printemps,
intitulé: Le divin tel que nous le concevons (Il divino concepito da noi) nous a
rassemblées. J’y participais avec un texte intitulé: Au coeur du Proche - Orient
ancien, l’opposition entre Yahvé et Astarté révèle-t-t-elle un combat entre deux
mères ? Il traite de l'affrontement entre le Dieu d'Israël et les dieux
canaanéens: les baals et les astartés, compris comme un conflit entre les dieux
de la nature: la Grande Déesse Astarté n'est-elle pas aussi Mère Nature ? - et
le Dieu d'Israël. Mais ce dernier, se présente comme mâle dominant, est parfois
mis en question de l'intérieur - même du peuple par certain-es prophètes et
prophétesses, qui le signifie par le rôle maternel (donnée dont j’ai poursuivi
l’élaboration et rendu compte dans un texte récent intitulé ‘Maternité et
altérité : le rôle maternel une représentation en travail dans la symbolique du
divin’).
Une voie moins conflictuelle s'ouvre ainsi pour saisir le lien entre le féminin
et le divin, puisque ce genre a été allié, d'une certaine manière, au Dieu
d'Israël. Les femmes (et le féminin) ne sont pas à placer purement et simplement
du côté des prêtresses de la Grande Déesse.
J’ai proposé , alors, de considérer que l'être humain peut entrer en contact
avec deux types de mères : une mère ‘en nature’ et une mère ‘en Dieu se révélant’.
Car ni la nature ni le divin ne sont suffisants à un être humain, masculin et/ou
féminin, pour vivre sur cette terre.
J'ai donc souligné cette possibilité de découvrir une ‘mère en Dieu’, marquant
peut-être une différence avec la perspective philosophie. L’élaboration de cette
thématique s’est poursuivie depuis, s’affinant de part et d’autre.
b. Deuxième moment de dialogue, en automne : le
texte que j'ai construit au sujet de la prophétesse Miryam, qui accompagna
l'Exode. J'avais travaillé ces matériaux pour une rencontre de travail
psycho-spirituel,portant sur la thématique du corps, avec des groupes de femmes.
Les éléments qui forment l’ossature de ce texte sont les occurrences bibliques
dans lesquelles Miryam est mentionnée, ainsi que les propos de quelques
auteur-e-s qui les ont commentées. J'ai ainsi opéré une reconstruction de la
présence de la prophétesse, à ce moment-là de l'histoire du peuple élu. Ce fut
avec une grande joie que je la vis ainsi reprendre corps et vie alors
qu'auparavant je n'en avais pas entendu parler. Une petite parcelle de la
mémoire spirituelle féminine était de nouveau accessible ;une sortie du vide, du
silence, de l’absence, était ainsi entamée…
Cette figure, qui inaugure la série de textes du volume édité par Luce Irigaray:
Le souffle des femmes, se distingue, implicitement il est vrai, de plusieurs
autres textes du volume, et du titre en particulier, en ce qu'elle porte en elle,
le souffle-respiration d'une femme - sa nephesh dirait-on en hébreu - son
souffle de vie; et, de plus, Miryam étant prophétesse, est une personne qui
reçoit et transmet le Souffle-Esprit de Dieu au peuple élu - sa RouaH - dirait
l'hébreu. Elle le fait ici, en créant un geste et un chant (parole et musique)
qu’elle entonne avec d’autres. Ce rôle fut exceptionnellement tenu par des
femmes dans l'ensemble de l'histoire du peuple élu. Il n’a pas cessé avec la
venue de Jésus-Christ. N’ y a-t-il pas des prophétesses nommément citées dans le
Nouveau Testament ! Et aujourd'hui ? Une telle distinction doit-elle encore être
marquée ? Y a-t-il encore des prophètes et des prophétesses ? Ou chaque
croyant-e peut-il/elle - à certains moments de sa vie, en certaines
circonstances - être annonciateur, annonciatrice d’avenir pour le peuple ? Etre
inspirateur, inspiratrice de l'attitude à avoir envers Dieu ? De l'action à
mener pour que l'histoire avance ? Je laisse cette question ouverte…
c. Troisième moment de différenciation, en hiver,
rencontre à Lausanne. Le colloque s'intitule différence et/ou égalité. Il est
inscrit en éthique.
C'est encore à propos de la notion de souffle, volontairement peu différenciée
de celle d'esprit, que je souhaite me distinguer de vous, Luce Irigaray. Vous
cherchez, depuis un certain nombre d'années, une voie spirituelle par le yoga -
dit du souffle - qui s'inscrit dans une perspective bouddhiste fort intéressante.
Si j’en ai bien compris l’enjeu, il s’agit d’apprendre à tisser la respiration
et le corps pour que se constitue une vie unifiée en une personne entière. C'est
un travail d'âme-souffle. Cela constitue, à mes yeux, une zone d'ancrage de la
vie dans le concret du corps et de la respiration qui renforce l'équilibre d'une
personne inscrite dans la réalité d'un moment d'histoire. Une telle pratique
peut être très bienfaisante, car notre mode de vie fait éclater le temps et
l’énergie dispersés de tous côtés.
Cependant, où je résiste, c'est lorsque ce travail d'âme-souffle est amalgamé à
la vie du l'esprit-souffle d'une personne. La question du lien entre ces niveaux
d’être mérite d’être formulée, et méditée…Et, c’est à ce point d’articulation
nommé ‘souffle ou ‘âme ou ‘cœur(en hébreu-Lev) que nous nous sommes rencontrées.
Je souhaite, pour ma part, que le corps et l'esprit - liés entre eux par ce
souffle - cette âme – soient considérés, chacun pour leur valeur propre et leur
vie propre, c'est-à-dire, avec entre eux aussi, de la différence, qui puisse se
manifester au sein de cette unité corps-esprit qu'est la personne.
Cependant, où je résiste à votre manière de voir la situation des femmes, c'est
dans ce que je comprends du rapport entre le corps et l'esprit tel que vous
l’avez dit parfois. Lorsque, dans certaines pages (mais il est vrai que votre
pensée me semble plus ouverte sur ce point qu’en ces pages anciennes de ,par
exemple, ‘Et l’une ne bouge pas sans l’autre ‘,Minuit, Paris,1979) vous avez
essayé de donner une forme à l'esprit féminin qui devait ressembler à la
configuration corporelle féminine..., j’ai résisté et je résiste encore. Je peux
entendre cette sorte d'isomorphisme entre l'esprit et le corps de manière
partielle, mais il me semble pouvoir dire, à partir de l'expérience que j'en ai
aussi, que davantage de différence devrait être placée entre le corps et
l'esprit, même s'ils comportent une zone commune (que vous travaillez par
exemple, par le yoga du souffle).
Dire encore que l'esprit d'une femme peut fort bien saisir des productions
symboliques de toutes sortes, y entrer, chercher à les comprendre, sans avoir à
garder une forme proche de sa forme corporelle.
De plus, le féminin lui-même, n’est-il pas constitué de colorations variées,
d’une musicalité, de mouvements étonnants, et d’inconnu. Certes, l'esprit
s'élance du particulier - du genre/corps - mais n’est-il pas capable d'explorer
de vastes régions, de prendre des formes diverses et que nous ne soupçonnons
peut-être même pas encore, et de revenir vers sa base, le corps sexué, d'où il/elle
est parti-e, où il/elle est ancré-e ?
Par conséquent, je plaide pour davantage de différence, donc d'altérité et de
liberté, entre le corps et l'esprit, sans les délier complètement l'un de
l'autre (me distinguant ainsi du courant américain du post-gender).
L'esprit humain, à l'image de l'Esprit divin, ne se colore-t-il pas parfois de
masculin, parfois de féminin, parfois de neutre ?
Le genre est un point d’ancrage corporel incontournable, une particularité qui
peut servir de base à l’esprit, qui lui-elle, peut voyager sous bien des
latitudes, et revenir à ce point, ce corps, sa maison.
3. Luce Irigaray m'invite à penser la théologie avec
la différence
Au sein de l’héritage spirituel chrétien, on peut repérer des éléments de la
différence manifestée au cœur de l’immanence : le Dieu-qui- vient (surmontant la
toujours plus grande différence que ressemblance...) dont ont parlé bien des
prophètes bibliques et quelques Sages.
Le Dieu qui se mêle du jeu des différences, se plaçant comme Altérité en
interlocution. Le Dieu qui garde l'intervalle au sein-même de sa manière de se
faire connaître de l’humanité genrée. Le Dieu qui accompagne l'un et l'autre
genre jusque dans les situations les plus dramatiques.
Votre œuvre m’a permis de revisiter et de restaurer (avec d’autres) ce côté
féminin de l’humanité, écrasé, nié, dispersé, effacé par le côté masculin, et
donc, de lutter contre une certaine forme d’idolâtrie assimilant purement et
simplement le genre masculin et Dieu. Elle m’a incitée à créer ou re-créer des
formes du féminin, visibles pour tous, dans mon espace de réflexion théorique et
dans mon écriture personnelle. Je mentionne ici trois directions où la pensée de
la différence a une influence.
a. Dieu, avec la différence
Penser le genre dans le champ de travail qui m'occupe d'abord:le théologique,
m'a incitée, assez rapidement, en parallèle avec le débat que vous menez avec
les Italiennes restitué, par exemple, par Elisabeth Green,de la revue Concilium
(263-1996,167-176), à travailler le lien entre le féminin et le divin. Vous avez,
notamment , pris position dans un article célèbre, intitulé: 'femmes divines':
signalant une importante lacune dans la représentation que les femmes avaient de
leur devenir.
Les Italiennes ont cherché à penser ce lien, soit philosophiquement à partir de
la mère réelle, soit théologiquement à partir de Marie, la Mère de Jésus-Christ.
J'ai, pour ma part, mené une recherche sur ce lien entre le féminin et le Dieu
de la Révélation à partir de la figure de la Sagesse personnifiée dans l'A.T. la
choisissant, entre autres, parce qu'elle ne relève pas uniquement du rôle
maternel. Bien qu'à une certaine distance, votre oeuvre m'a accompagnée durant
toute cette période.
Cependant, j'avais affaire à une Altérité qui semblait excéder l'altérité du
genre masculin à laquelle vous résistiez. J'ai donc été amenée à poursuivre
encore cette approche par d'autres voies, m'intéressant à d'autres différences
de cultures, d'âges, de classes sociales. Il m'en vient quelques questions quand
à l'unique représentation de l'universel par les deux genres ... Comment, avec
le modèle de la différence sexuelle, rendre compte de ce 'bien commun' (notion
de P.Brückner) qui transparaît à travers les différences pour constituer une
sorte de territoire commun, réel ou virtuel, entre les hommes et les femmes ? (
Comment expliquer, par exemple, que je puisse me sentir plus proche d'un homme
d'une autre culture dans telle ou telle situation, que d'une femme ? etc.) Pour
dire l'universel, n'y a-t-il pas d'autres dimensions encore, à prendre en compte
? N'y a-t-il pas une variation de la place à donner à cette différence-là ?
Toujours là certes, mais n’occupant pas toujours le premier plan dans telle ou
telle situation ?
Ou pour emprunter les mots de l’ historienne Geneviève Fraisse, parlant du
sujet-femme: " Le sujet-femme composé par l'histoire du féminisme est à la fois
neutre et sexué, et il recherche un point d'équilibre entre deux mouvements:
celui qui met fin à la dépendance d'un être morcelé par les qualités relatives
et celui qui sait que le sujet femme n'est qu'une des positions de la femme
comme être humain, ce sujet n'épuisant pas la totalité de son rapport au monde".
G. Fraisse, Les femmes et leur histoire, Gallimard,1998, p.447, ch.13: Individue,
actrice, sujet.
Penser, maintenant, avec votre proposition du 'deux comme universel' le lien à
l'Altérité qui me préoccupe comme théologienne... est nouveau pour moi. Je tente
cependant d'en dire quelque chose à cette occasion: ne pourrait-on la comprendre
comme garante de l'espace entre, de l'écart entre les genres, et comme (initiateur
ou) initiatrice du mouvement entre eux, accompagnant leurs rapprochements et
leurs prises de distance, jouant avec l'un ou l'autre genre pour communiquer
avec l'autre, tissant ici aussi (comme entre le corps et l'esprit) une résille
relationnelle ? Trouvant son intérêt propre à cette partition de l'universel, en
ce qu'elle garde, et l'un, et l'autre genre, de devenir idole.
Enseignement issu de la situation actuelle de la pensée de la différence de
genre, car, c'est en désintriquant le féminin du masque du neutre, en réalité le
masculin devenu idole, que l'espace et le tissu relationnel commencent à se
reformer entre les femmes et les hommes et que peut se déployer le lien à la
réalité spirituelle dite par Altérité divine se révélant (Là, peut être saisi,
le mouvement d'un-e Autre divin-e qui vient à nous, homme et femme, porté par
des autres variés, pour accompagner notre devenir).
Peut-être encore comme Celui /Celle qui, surmonte, en la retraversant, la
toujours plus grande différence que ressemblance, en usant d'une forme de
l'analogie, pour venir rencontrer nos identités particulières jusque dans le
genre et y rendre présente l’Imago Dei’?
b. Le salut par la création, avec la différence
Dès la première lecture de l’un de vos textes (et j’en ai rendu compte plus
haut) votre créativité langagière – en particulier philosophique – a suscité la
mienne et celle de bien d’autres. Création de formes symboliques féminines, d'un
langage qui porte les marques du genre, d'une pensée qui restitue le point de
vue des femmes sur telle ou telle problématique de la vie. L’orientation de mon
travail théologique vers la figure de la Sagesse personnifiée se situe
précisément dans cette perspective.
c. La vie communautaire – ecclésiale - avec la
différence
Dire que la vie communautaire entre disciples égaux est une notion qui a été
exhumée de l'histoire des premiers temps du Christianisme par les travaux de Mme
E. Schüssler-Fiorenza, d'une part,qu'appartenant à une Eglise qui reconnaît ce
statut égalitaire entre hommes et femmes (depuis la Lettre de Paul aux Galates
au moins) d'autre part, j'observe cependant, que cela ne suffit pas à le vivre.
Dans la pratique, en effet, à partir de l'égalité, de la différence surgit,
perturbant ce statut. Ce que, les unes et les autres, ne savons pas toujours
comment traiter. C'est là un des points sur lesquels votre pensée et vos
propositions concrètes à inscrire dans le culturel, peuvent nous aider à
progresser.
Quant au fondement de la communauté, il demeure lié à une personne singulière
jusque dans son genre, le Christ incarné en Jésus de Nazareth, et non pas, ou
pas d'abord à un couple, donc à de l'universel.
Personne singulière1 humano-divine qui, en sa dimension humaine, est une
singularité en communication avec d'autres singularités, hommes et femmes,
alliées ou non entre elles; et en sa dimension divine, est en communication avec
un Dieu trinitaire à l'intérieur duquel il convient de ne pas de bloquer le jeu
des genres ».
S’ouvre alors une nouvelle perspective, ce qui est connu de son existence ne
peut-il offrir un lieu de réflexion pour le questionnement énoncé plus haut au
sujet de l’articulation entre corps-respiration et souffle-esprit –Esprit Saint
? Son genre est-il un obstacle suffisant pour que l’autre genre ne s’en
préoccupe plus ?
© copyright,michèle bolli, lausanne.